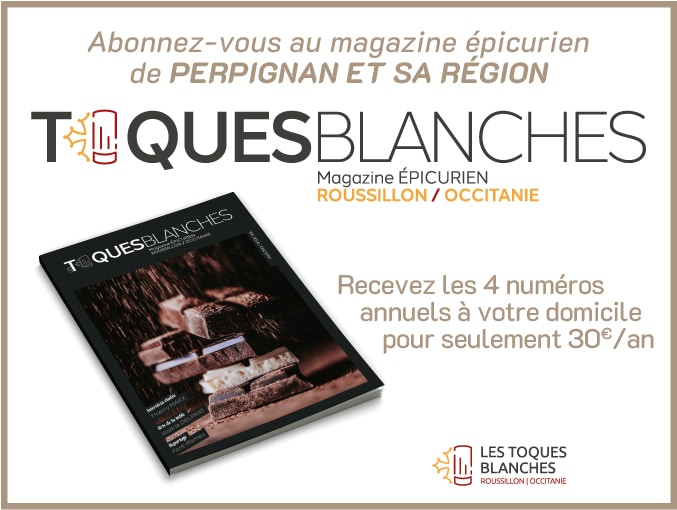“Je suis viscéralement un sommelier au service des chefs”.
Pour la première fois, nous avons choisi ce format d’entretien croisé. Et nous avons adoré : une conversation à deux voix, vivante, sans apprêt, où l’on parle autant de trajectoire que d’un métier qui se réinvente, parfois à contrecœur. Stéphane Sabathé, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, et Olivier Zavattin, maître sommelier devenu consultant, déroulent un récit aussi franc que précis : carrière, transmission, terroirs, tendances, crise et quelques souvenirs qui donnent le sourire.
 Stéphane Sabathé : Votre parcours, Olivier, en quelques repères ?
Stéphane Sabathé : Votre parcours, Olivier, en quelques repères ?
Sorti de l’école hôtelière du Moulin à Vent de Perpignan, j’ai achevé mon cursus en stage aux Feuillants, à Céret. Enfant de la vallée de l’Agly, entre Saint-Paul-de-Fenouillet et Maury, j’y ai trouvé mes premières boussoles. Aux Feuillants, Marie-Louise Banyols m’a formé et préparé aux concours. À 24 ans, cap chez Gilles Goujon, à l’Auberge du Vieux Puits : premier poste de directeur de salle, maître d’hôtel et chef sommelier, avec l’envie d’en découdre en concours. Puis la Suisse : une maison qui passe de deux à trois macarons, et, à 25 ans, l’un des plus jeunes chefs sommeliers d’un trois étoiles en Europe. Retour en France : Domaine d’Auriac, puis Grand Hôtel Moderne et Pigeon auprès de Jean-Luc Desmoineaux, une maison bourgeoise où je me pose. Suit l’aventure Gérard Bertrand : direction de la restauration, marketing, gestion, trois ans en fixe, puis sept ans comme consultant et ambassadeur. Retour au pays, directeur au Fanal (Banyuls-sur-Mer). Il y a trois ans, un grave accident m’a tenu loin des salles. J’ai créé une société de consulting et une agence commerciale. Je travaille notamment avec le Clos des Constellations et le Domaine Bellevue-Saint Georges sur la vision, la stratégie et le développement. Mais je suis viscéralement un sommelier au service des chefs.



Comment voyez-vous l’évolution du métier ?
On a ouvert le périmètre : sommelier en salle, caviste, consultant, grande distribution… C’est l’évolution « moderne », mais fragile. On a galvaudé le terme sommelier ; tout le monde s’en est emparé sans que le service suive partout. Je défends une sommellerie puriste : la salle, les accords mets-vins, la cave, la collaboration intime avec la cuisine. Et je le redis : il faut protéger ce cœur de métier, tout en acceptant qu’après 50 ans, on puisse évoluer vers d’autres fonctions.
Un conseil aux élèves et apprentis qui rêvent d’ouvrir une cave ou d’être sommeliers ?
Allez au bout de la mention complémentaire ou du BP sommellerie. Ce sont des métiers d’ascenseur social : en cinq à dix ans, on voyage, on se cultive, on progresse vite si l’on travaille. Peu de places, mais des situations et des salaires intéressants pour qui s’accroche.



Ce qui vous passionne le plus ?
La transmission. Et l’ambassade d’un terroir. Depuis mes 17-18 ans, je promeus les vins du Roussillon : Maury, Banyuls, la vallée de l’Agly. On raconte une région avec les chefs, partout.
Les vins du Roussillon sont-ils reconnus à leur juste valeur ?
Les étoilés sont des vitrines : on y voit nos vins, et cela fait rayonner. Économiquement, ce n’est pas ce qui fait vivre tout le monde, mais la visibilité est là. On a eu 20 ans de retard même si le savoir- faire y était. Aujourd’hui, des domaines comme le Clos des Fées ou le Clos des Constellations sont recherchés, y compris à l’international. Il reste du chemin, mais on y vient.
 Vos liens avec les artisans du goût ?
Vos liens avec les artisans du goût ?
Trente-cinq ans de carrière, des amitiés forgées très tôt avec des vignerons. On a grandi ensemble : fraternité, concret, pas de virtuel. On connaît les vignes, les vins et les personnes.
Biodynamie, vins nature : votre regard ?
La biodynamie n’a rien d’un effet de mode. J’ai vécu le virage du bio chez Gérard Bertrand : c’est mieux pour la planète et pour les êtres. Les vins nature ont fédéré, rajeuni la clientèle, offert un vecteur social à l’heure des pressions sur l’alcoolémie. Beaucoup viennent d’ailleurs s’installer ici parce que nos terroirs — mer, montagne — sont exceptionnels. Le Roussillon a été pionnier sur ces vins.
Concernant les tendances de consommation : votre constat de terrain ?
C’est une catastrophe commerciale : sur des terrasses pleines, une bouteille de vin pour 30 couverts, le reste en bière. Les brasseurs ont réalisé le travail de prescription que nous n’avons pas assez fait auprès des restaurateurs. Résultat : les vignerons en grande difficulté, et c’est une alerte rouge sur l’économie locale.
Patrimoine vitivinicole, mondialisation, climat… où va-t-on ?
Ici, on risque de perdre la moitié du vignoble dans sept à dix ans : climat, concurrence, marchés export en berne (États-Unis, Chine, Russie). Des cuves pleines avant vendanges, des mises en bouteille faute de place… Socialement, ça casse. Il faut des stratégies : aller vers l’ultra-premium pour certains, diversifier (œnotourisme, oliviers, fruits, élevage), capter le tourisme, remettre l’époux/épouse au travail si besoin. Le vigneron doit penser chef d’entreprise.
Je rebondis sur l’actualité et l’incendie dans les Corbières…
C’est un désastre : économique, social, touristique. Les commandes s’annulent, l’impact est direct. On paie aussi l’arrachage, la perte d’entretien des paysages, l’eau qu’on n’a pas su amener. J’espère qu’on ne sera pas abandonnés une fois l’émotion retombée.
 Dans votre cave personnelle, que trouve-t-on ?
Dans votre cave personnelle, que trouve-t-on ?
De tout : effervescents, rouges, blancs, rosés, doux. Beaucoup de Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Vallée du Rhône, Catalogne/Espagne, et Corse. J’achète peu de grands vins américains. J’aime les magnums.
Un terroir fétiche ? Un vin fétiche ?
Maury. Schistes, vins doux naturels : c’est mon enfance, mes marqueurs de goût.
Le vin le plus rare que vous ayez dégusté ?
Un 1895 en Rivesaltes, dans une collection “Legend Vintage” : 20 bouteilles au monde. Émotions fortes aussi avec un Maury 1925 (famille Volontat), de très vieux millésimes en Bourgogne et Val de Loire.
Comment compose-t-on un accord mets-vins qui “tient” sur un long menu ?
Ce n’est pas de la fanfaronnade : c’est technique et compliqué, surtout sur sept à neuf plats. Il faut connaître la cuisine, les produits, travailler en fusion avec le chef. La clé “maison” pour des amateurs ? Regarder la couleur. Tarte au citron ? On reste jaune, un Muscat de Rivesaltes, par exemple, pas un vieux rouge chocolaté. Rouget ? On peut jouer orangé/rosé. Fromage de chèvre ? Blanc sec équilibré. Et méfiance : asperge et surtout artichaut détruisent l’accord.
Une ou deux anecdotes pour la route ?
Au début de ma carrière, aux Feuillants, j’avais “deux-trois mois” de sommellerie derrière moi, sous l’œil de Marie-Louise Banyols. On avait la chance d’avoir une Romanée-Conti en cave, le genre de bouteille qui “fait toute la carrière d’un restaurant”. Un soir de 1994-1995, un client russe prend la carte, pointe le prix le plus élevé et me demande la visite de la cave. En bas, je comprends qu’il ne sait ni ce que c’est, ni le cépage : il a choisi par tarif. J’ai refusé la vente, puriste que je suis… je me suis bien fait engueuler. Une autre histoire. En Suisse, dans un trois macarons complet six à sept mois à l’avance (25 couverts, des clients qui prennent l’avion pour venir), un financier très célèbre, Bill Gates, doit dîner. Toute l’après-midi, ses assistantes téléphonent : “on sera 9… 7… 4… 5…”. J’étais chef sommelier, j’assistais le directeur. Le chef me dit “dites oui et attendons qu’ils arrivent”. Le soir venu, le chef sort de la cuisine : “Vous me prenez pour qui ? Vous ne me respectez pas ? Moi je galère toute la journée, vous avez embêté mon chef sommelier… Nous, on ne fait pas la dînette”. Refus net. Ce soir-là, pas de table pour lui.